
Cultures-J.com : Bonsoir Popeck, merci de nous recevoir. On vous a vu seul en scène, au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Où va votre préférence, et pourquoi ?
Popeck : La télévision, pour moi, c’est une obligation relationnelle pour le métier, parce qu’on ne peut plus faire autrement. C’est un passage obligé, sinon on est oublié totalement, malheureusement. Mais c’est de loin la scène que je préfère, là où je m’exprime le mieux.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre carrière ?
Je suis très franchement estomaqué, plus que flatté, je n’en reviens pas. Je pensais que j’aurais dû depuis longtemps arrêter, non pas pour une question physique, car je me sens en pleine forme, mais tout simplement parce que je me dirais : « mes sketchs sont dépassés. Le personnage est dépassé ». Eh bien pas du tout. Et c’est peut-être parce que tous les jeunes humoristes se copient un peu les uns les autres, qu’ils sont un peu tous sur le même registre. Et si il n’y avait pas la télé pour faire référence, ils n’auraient pas grand-chose à raconter. Moi je ne prétends pas intéresser les 15-20 ans, ils ne me connaissent pas, mais ça ne me dérange pas puisque je suis toujours là. Je remplis les salles. Je ne suis jamais resté sur mes lauriers. Des fois on dit : « Ah oui Popeck c’est les caleçons molletonnés ». Si ce n’’était que ça, il y a longtemps que ce serait fini. J’ai toujours travaillé à surprendre, à étonner quelqu’un qui vient ou qui revient. Il y a le bouche à oreille, c’est peut-être pour ça que j’ai toujours du public. Et puis, je vais vous dire une chose étonnante : on pourrait dire « il y a une chose qui est bizarre chez Popeck, c’est à la fois de l’humour juif et ce n’est pas de l’humour juif ». Si on veut bien gratter entre les lignes, c’est de l’humour juif tel que le vivaient les ashkénazes. Les ashkénazes presque assimilés, vivant en France.
D’où vous est venu le sketch de Moïse le poisson rouge, que vous baladez dans les bassins du château de Versailles ?
C’est du surréalisme. Comment m’est venue cette histoire-là ? Je n’arrive pas à m’en souvenir. Combien de fois j’ai voulu l’abandonner. Et c’est le producteur, partout où j’allais, qui me disait de la garder. C’est comme l’histoire de la guitare avec les pompons, c’est surréaliste. C’est invraisemblable. Et ça aussi c’est un miracle. Cette guitare aurait dû se briser en mille morceaux cent fois. Et le miracle c’est qu’elle joue juste. Le miracle c’est qu’elle tient. J’ai un nœud papillon qui tombe en lambeaux, il est toujours là. Le chapeau, je ne vous raconte pas d’histoires, voyez, je vais le sortir pour vous (il sort son chapeau melon du sachet où il l’avait rangé). Il était déjà à l’Ecluse ce chapeau-là. Vous allez bien regarder ce que je vous montre. Il est rafistolé… (il rit. On voit du scotch à l’intérieur du chapeau). Il y a des trous, il y a du scotch… mais c’est un chapeau mythique pour moi. Si je n’ai pas le chapeau, je n’existe pas. C’est comme ça. Il y a des choses comme ça qui font qu’on peut croire en D.ieu. Il y a des Juifs ashkénazes qui ne croient plus en D.ieu depuis Auschwitz. Moi je suis certainement un mohican dans ce domaine-là. Mais le phénomène c’est que ça plaît aux non-Juifs. Et je n’ai jamais ressenti un relent d’antisémitisme. Jamais, en 40 ans de carrière. Du temps de mes premières parties des grandes vedettes, il y avait un Noir, qui était très drôle à l’époque, et qui était très décrié par la communauté noire, comme moi je pouvais l’être par les Juifs au début, pour faire rire des non-Juifs. Donc c’était suspect. Et lui il faisait rire parce qu’il faisait un sketch où il faisait le balayeur. Très drôle, son sketch. Mais les Noirs disaient : « Ca nous avilit ». Et on a pu penser ça de moi : Popeck, les Juifs radins, le Juif près de ses sous… Ce Noir me disait : « Nous, on sera jamais sifflés, ni toi ni moi. » Parce que les premières parties étaient toujours sifflées. Ils attendaient la vedette. Le public n’était pas comme aujourd’hui, on leur donne des couleuvres, ils les avalent. Avant, le public était beaucoup plus dur. Et donc, ce Noir me dit qu’on ne sera jamais sifflés. Je lui demande pourquoi, et il me répond : « Parce que moi je suis Noir, les gens vont pas oser me siffler sinon on va les traiter de racistes, et toi on te sifflera pas non plus sinon on va les traiter d’antisémites ! » Et c’était vrai.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune humoriste ?
S’il est capable de faire autre chose, il fera autre chose. Si il est touché par un virus, il ne fera que ça, parce qu’il ne pourra pas faire autre chose que ça. Beaucoup d’artistes ne réussissent pas et continuent quand même parce qu’ils ne veulent pas faire autre chose. Ce que je fais là, ce n’est pas ce que j’ai souhaité faire. C’est parce que c’est ce que je fais de mieux. Malheureusement. Moi j’aurais voulu changer de personnage à chaque fois, tout le temps. Etre capable comme un Richard Berry, comme un Daniel Auteuil, comme un Thierry Lhermitte de faire 36 choses différentes, ça aurait été mon rêve. Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Si on ne vous engage pas, qu’est-ce que vous faites ? Vous restez sur le créneau sur lequel vous êtes. Puis un jour, il n’y a plus que ça qui fonctionne. Quel conseil je peux donner à un jeune ? Je n’en sais rien. Quand je rentre sur scène, je me dis que tout est à recommencer. Et des fois, je m’adresse au public, comme ce soir, je dis des choses que je ne devrais pas dire. Par exemple : « Il va falloir que je recommence à dire tout ce que j’ai dit hier soir ? Mais hier soir, j’ai tout dit. Alors encore tout recommencer ce soir ? ».
Est-ce que cela veut dire qu’il y a une lassitude de votre part ?
Un peu, oui. Je me dis : « Ca va marcher moins bien. » Hier soir, ça marchait tellement fort que ça ne peut pas marcher aussi bien. En plus je n’ai pas tort. Je ne me trompe pas. Il y a un manque de confiance, et puis il y a aussi une appréhension du public qui m’est toujours restée. Même les plus grands acteurs l’ont, cette appréhension. Certains justifiaient leur culot par la boisson, voire par l’alcool. Mais quand vous n’avez pas ces ingrédients… C’est-à-dire, quand vous n’avez pas de talent, vous pouvez dépasser le talent en prenant de la drogue.
Mais vous, vous n’avez jamais eu besoin de ça.
Non. Peut-être par lâcheté. Pas par courage en tout cas. Par lâcheté je n’ai jamais osé y toucher. Il y a un très beau poème de Jacques Prévert qui parle du courage. C’est un marin breton qui n’a jamais osé traverser la rue. Il n’osait rien parce que depuis qu’il était petit, on lui disait « tu n’arriveras à rien ».
Vous m’avez dit que vous avez eu les encouragements de vos professeurs…
Ah oui ! Mais à l’époque j’avais déjà 18 ans. Les premiers qui m’ont encouragé, c’était à la Varenne, quand j’ai monté une pièce pour Hanouka. Mais c’est bizarre que ces mêmes gens, une fois que j’ai commencé à avancer dans ce métier, ont dit : « Bon, et à part ça ? Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas rester à faire le schnorrer (du yiddish « mendiant » NDLR) ? » Alors au début ils vous encouragent, et puis au bout d’un moment, à plus de 30 ans, ce n’est plus très sérieux, il faudrait faire un « vrai » métier, passer à autre chose. Je suis resté très lié avec des moniteurs que j’avais quand on avait 15 ans. Bizarrement, ces moniteurs, qui étaient dans des maisons juives, ne sont pas juifs. Ils étaient de grands psychologues, mais ils ne le savaient même pas eux-mêmes. On va souvent chez l’un d’eux, et quand on était tous en train d’essayer de monter, de se faire connaître, on demandait des conseils. Et je me souviens que moi, à ce moment-là, j’étais au cabaret. Ils m’ont invité à déjeuner, ils étaient deux. Je me rappellerai toujours ce qu’ils m’ont dit : « Bon, tu en es où ? » « Ben je suis au cabaret. » « Et ça va te mener où ? » Voilà. Tu en es où ? Ca va te mener où ? C’est exactement ce que me disait ma sœur. On est donc seul. A un moment donné, on est tout seul. Parce que tant que vous n’êtes pas connu, et que vous êtes encore moins reconnu, vous êtes tout seul. Au début on les encourage : « Ah oui c’est chouette ! ». Ils commencent les cours d’art dramatique, mais après, ils deviennent quoi ? Il se passe quoi quinze ans plus tard ? Vous savez, moi, j’ai une photo avec tous les élèves de ma classe. Je regarde puis je me dis : « Il y en a combien là-dedans qui sont toujours comédiens ? » Je me souviens de presque tous. Voilà. C’est pour dire que quand on est reconnu, le plus difficile c’est de garder la tête sur les épaules. La seule qualité qu’on pourrait dire de moi, c’est peut-être que je suis resté simple. De même que je suis resté fidèle. Mais comme je dis souvent, si j’avais été une vedette à 25 ans, à 30 ans, il y a longtemps que je ne serais plus avec ma femme. Il y a trop de tentations. Tu tournes un film, tu dois embrasser une fille…
Justement, à propos de film, pouvez-vous nous raconter une anecdote sur Rabbi Jacob ?
Oh, j’en ai beaucoup sur Rabbi Jacob. J’ai beaucoup sympathisé avec Louis de Funès. J’ai beaucoup de lettres de lui, je me souviens de conversations téléphoniques… C’était un anxieux. Très anxieux. Il aimait bavarder avec moi, peut-être parce qu’il savait que j’avais peu de chances d’atteindre son niveau. Et donc, on se confie, un peu comme dans un train, quand vous vous confiez à des gens que vous ne reverrez jamais ! Il se confiait à moi comme il ne se serait jamais confié à des personnalités beaucoup plus connues que moi. Un jour il m’a demandé d’aller au Jardin des Plantes surveiller une variété de poires. Il m’a dit : « Vous comprenez, si moi j’y vais, tout le monde va me demander des autographes, tandis que vous, vous ne risquez rien, vous n’êtes pas connu. » Le lendemain je suis revenu, j’avais tout noté, j’arrive dans sa loge, et on me dit « personne ne rentre dans la loge de Louis de Funès ». Puis l’habilleuse dit : « Ah si, lui, il peut ». Ce film, c’est mon meilleur souvenir. La seule chose, c’est que je n’ai pas su attraper la perche qu’on me tendait alors. Gérard Oury m’a tendu une perche au moment où il était au summum de sa notoriété. Et la preuve, c’est qu’au générique de Rabbi Jacob, je n’apparais pas sous le nom de Popeck, mais de Jean Herbert. Parce que je n’y croyais pas. Et pourtant, quand Gérard Oury m’a appelé chez moi pour prolonger mon séjour de deux mois dans Rabbi Jacob, il aurait suffi que je dise : « Non non, moi ce n’est pas de prolonger mon contrat qui m’intéresse. Je veux un vrai rôle. Puisque vous m’appelez chez moi c’est que tous les producteurs et Louis de Funès ont découvert que je pouvais être quelqu’un. Donc, je veux un vrai rôle, pas dire une phrase de temps en temps ». Et je vous jure que ça aurait marché. Il se serait mis au boulot, avec l’accord de de Funès, parce finalement, ils se sont aperçu que j’étais utile. Mais ce n’est pas ce que j’ai dit. Je voulais me faire oublier au contraire, sinon je n’aurais pas mis Jean Herbert au générique. Il m’a posé la question : « Pourquoi est-ce que tu ne mets pas Popeck ? Tu as un nom ! » « Mon nom c’est Jean Herbert. » Jean Herbert avait eu le premier prix chez René Simon. Jean Herbert avait joué Dostoïevski. Jean Herbert avait joué Arthur Miller. Jean Herbert avait joué Maître Puntila et son valet Matti de Brecht. J’étais quelqu’un, merde ! Je croyais que j’étais quelqu’un. Mais dans la vie, je n’étais rien. Philippe Bouvard a dit un jour de moi : « S’il avait le culot dans la vie qu’il a dans les caméras dissimulées, (j’en ai tournées avec lui), il serait loin. » Je n’avais aucun culot. D’ailleurs quand on va quelque part, c’est mon assistant qui me met en avant. Si on prend l’avion, il demande: « Vous ne pouvez pas mettre Popeck devant ? « Moi je ne demande jamais ça. Et il l’obtient ! Je n’utilise pas mon nom. Et un jour, je me suis fait arrêter, je rentre dans le car des flics pour l’amende, et j’en ressors en signant des autographes. Quand on a demandé à de Funès : « Qu’est-ce que vous a apporté la notoriété ? », il a répondu : « La considération de ma concierge. » Au début, quand je faisais du cabaret, la concierge me voyait rentrer à deux heures du matin, cheveux longs. J’étais suspect à ses yeux. Puis quand un soir elle est venue me voir au café-théâtre, le lendemain j’étais une vedette. Tout avait changé.
Pour finir, où a-t-on le plus de chances de vous croiser à Paris ?
Je descends faire ma gym sur l’île de Puteaux. Quand vous descendez du pont de Neuilly, vous avez en bas un jardin avec des stades, qui va d’un pont à l’autre, du pont de Neuilly au pont de Puteaux, et s’il ne pleut pas, j’y suis tous les jours. Je fais de la marche. Je marche beaucoup, je fais des tours de stade quand il n’y a pas de compétition, il y a des appareils pour faire de la gym. Je m’entraîne, physiquement et vocalement. Tous les matins je fais une demi-heure de gym au sol, après je fais du vélo chez moi, j’ouvre mes fenêtres, je regarde des trucs que j’ai enregistrés, et je pédale. Tous les jours. Mais il faut ouvrir les fenêtres. Par n’importe quel temps. Il faut accepter de se mettre en petite tenue, et d’ouvrir la fenêtre. Et vous vous apercevez que, petit à petit, l’endurance arrive.
Ca fait longtemps que vous suivez cette discipline ?
Ca fait des années. Pendant trois ans je suis resté au café-théâtre, j’ai fait un peu plus de 1.000 représentations d’affilée sans avoir fait un seul jour de gym. Je ne savais même pas ce que c’était que la gymnastique. Je jouais sur les nerfs, j’étais agressif, j’en voulais à tout le monde. Il y avait encore plus de monde qu’ici. Les gens étaient assis sur la scène, par terre. J’aurais dû être heureux ; j’étais agressif, méchant. J’ai fait cinq fois l’Olympia, dans l’agressivité. J’ai fait le Palais des Congrès sans être heureux. J’avais un impresario qui était pire que moi, c’était une femme qui était très agressive, qui me renfermait dans une espèce de mystique. J’étais malheureux, et je ne me rendais même pas compte de la chance que j’avais à cette époque-là. J’ai gagné énormément d’argent, j’ai payé énormément d’impôts. Et je ne m’en rendais pas compte. Mais je crois que c’est une question d’âge. J’ai lu un truc pas mal : « la vie est un enchantement permanent, que l’on ne découvre qu’au soleil couchant ». C’est une histoire juive. Je ne vais pas lui dire que je suis content à mon producteur, parce que sinon, mon agent va me dire : Si vous lui dites que vous êtes content, je vais avoir du mal à discuter l’argent, moi. »
Propos recueillis à Paris en janvier 2014.
Si vous désirez aller plus loin :
On n’est pas des sauvages, de Popeck, aux éditions du Cherche-Midi. 187 pages. 19,00€.
De qui tu tiens ce don-là ?, de Popeck, aux éditions L’Archipel. 249 pages. 20,00€.
Incoming search terms:
- https://cultures-j com/rencontre-avec-popeck-par-johana-levy/


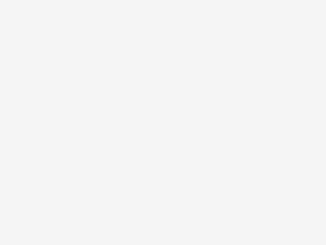


Cet article vous intéresse ? Laissez un commentaire.