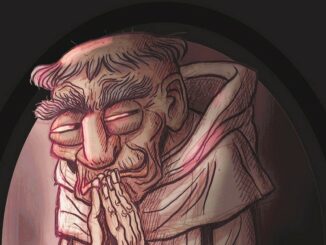On a beau savoir que, depuis quelques décennies, l’église catholique peine à se renouveler et que son état de santé n’a que peu de choses à envier à celui que connaissait le souverain Pontife depuis plusieurs mois, il est rare de le constater de manière flagrante.
Fondée en 1241, l’église Sao Domingo, au nord du Baixa de Lisbonne, entre le square D. Pedro IV et la Praça de Figuera, était à l’époque la plus grande église de la ville, célèbre pour ses douze chapelles et la splendeur de ses décorations. Les plus grandes cérémonies religieuses y étaient célébrées, ainsi que les mariages royaux et les messes funéraires. C’était alors le temps de l’opulence et de l’orgueil : un Portugal catholique et triomphateur impose ses volontés à l’ensemble de l’univers connu. Les fidèles lisboètes rendent grâce au créateur de bien vouloir leur offrir, à profusion, la jouissance des biens de ce monde. Les certitudes sont telles que l’église se fait forte de décider qui, parmi les humains, est digne d’elle ou pas.
C’est ainsi que, sur le parvis de Sao Domingo, un monument en forme d’étoile de David vient commémorer le « Pogrom de Lisbonne », nommé aussi « Tuerie de Pâques », qui eut lieu entre le 19 et le 21 avril 1506 et qui couta la vie à au moins deux mille juifs.
On raconte que le dimanche de Pâques, 19 avril 1506, alors que les fidèles étaient réunis pour prier, l’un d’entre eux crut voir, sur une peinture murale, le visage du Christ qui s’illuminait. Un autre affirma aussitôt que ce n’était que le reflet d’une bougie. Hélas, celui qui venait de s’exprimer était un juif parmi les milliers qui avaient, de façon toute récente, été convertis de force au catholicisme. Il n’en fallut pas davantage pour accuser d’hérésie. L’homme fut tiré hors de l’église par les cheveux, lynché puis brûlé vif. Et à sa suite, la populace ivre de sang, certes malmenée par plusieurs années de sécheresse, de disette et de peste qui lui faisaient chercher un bouc émissaire, se livra à un massacre. Les Dominicains, eux-mêmes, en soutane, le crucifix à la main, promettaient l’absolution immédiate à ceux qui tueraient les juifs convertis. Des marins de passage, étrangers allemands, hollandais, zélandais, se mêlèrent à la foule pour violer, égorger et piller. On parle d’enfants découpés en morceaux dans leurs berceaux ou projetés contre les murs ; on parle de bûchers improvisés au coin des rues dans lesquels hommes, femmes, vieillards, enfants étaient jetés vivants.
Le massacre prit fin, dit-on, lorsqu’un écuyer du roi, Joao Mascarenhas, fut tué par mégarde, confondu avec ceux-là que l’on nommait les « marranes », les juifs nouvellement convertis. Il y eut, prétendent les historiens, plus de deux mille morts en l’espace de trois jours à peine.
Mais le ciel, semble-t-il, se vengea. En 1531, un premier tremblement de terre endommage la chapelle principale et celui de 1755 achève de ruiner l’essentiel du chœur. Pour beaucoup, le tremblement de terre était un signe divin : on se souvient de la querelle – une parmi d’autres, il est vrai – qu’entretinrent à ce sujet Voltaire et Rousseau. Sao Domingo, comme une bonne partie du centre de Lisbonne, fut ravagée et il fallut l’énergie de la foi pour envisager de la reconstruire. Cela prit du temps, beaucoup de temps. Et, en 1918, l’église est classée monument historique.
Mais, alors que rien n’était vraiment achevé, le 13 aout 1959, un incendie terrifiant ravage Sao Domingo. Les flammes sont visibles depuis les sept collines de la ville et à plusieurs kilomètres à la ronde. Entre 20h30 et 3 heures du matin, ce sont plus de cent camions de pompiers qui luttent contre les flammes et les saints sacrements ne sont sauvés que d’extrême justesse par un des prêtres de la paroisse. Bien entendu, l’intégralité des trésors liturgiques, des peintures et des œuvres d’art en bois ne sont désormais plus que souvenirs. Il n’est même pas possible de célébrer la messe puisque le toit n’existe plus. C’est comme si Dieu voulait que brûle son temple et qu’ensuite il pleuve sur ses fidèles.
Par une sorte d’amère ironie de l’Histoire, comme il arrive à la religion d’en créer, le lieu fut affecté provisoirement aux populations africaines. Puisqu’on avait subi les tremblements de terre, le feu et la pluie, on pouvait bien, après tout, laisser les noirs célébrer le culte. Aujourd’hui encore le quartier rassemble une forte proportion de population d’origine africaine.
A partir de 1960 commencent la mise en place d’un toit métallique qui ne sera totalement achevé qu’en 1992. L’église sera réouverte au culte deux ans plus tard. L’architecte auteur de cette rénovation du toit a eu la discutable idée de recouvrir celui-ci d’une teinte carmin crasseux aux pigments naturels, mais qui n’est pas des plus heureuses et qui semble dénoncer encore plus l’état de délabrement du bâtiment.
Les colonnades, si elles s’élancent encore vers le ciel, sont lépreuses et décrépies. On dirait, partout sur les murs, la chair mise à nue. Les briques sont crues, sans crépis ni enduit. Les niches sont vides, comme autant de bouches béantes pleurant l’absence de statuaire. La pierre à vif semble, de partout, sur le point de s’effondrer. Même les maigres reliques restantes paraissent sales et sans attrait. Une statue de ce bon François d’Assise le représente avec, sur le visage, l’expression de la stupeur désolée.
De partout, ce ne sont que les reliefs en miette de ce qui fut, sans doute, un ensemble de décorations raffinées. Le sol lui-même est de pierre brute et raviné de fissures. On dirait quelque tragédie minérale et Sao Domingo n’est plus guère qu’une sorte de « Notre Drame qui pleure misère ».