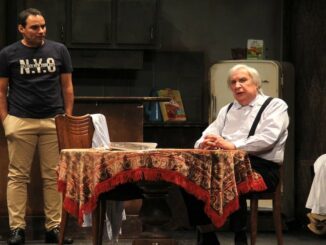On se souvient à quel point Nuremberg a pu paraître décevant pour les survivants de la Shoah : non seulement les dignitaires nazis clamaient leur innocence mais encore ils prétendaient ne pas comprendre de quel génocide on pouvait les accuser. Il faut bien préciser qu’avant d’évacuer les camps de la mort, ils avaient pris soin de soigneusement effacer toute preuve.
Néanmoins, la plus grande partie d’entre eux furent condamnés car, outre les témoignages, il subsistait un certain nombre de traces accablantes. Et parmi celles-ci, un « album de photographies » aujourd’hui conservé au Mémorial de Yad Vashem et dont nous entretient cette exposition. L’ensemble est composé de 56 pages et de 197 photos ; il est subdivisé en six parties et son titre est un glaçant euphémisme comme les chérissaient les nazis : « Réimplantation des juifs de Hongrie ».
Cet album a été réalisé entre mi-mai et début août 1944, et est l’œuvre du service anthropométrique d’Auschwitz dirigé par Bernard Walter et Ernst Hoffman.
Au début de l’année 1944, la communauté des juifs de Hongrie est la seule à avoir échappé au processus de destruction. Malgré les persécutions mises en place par régime de l’amiral Horty, la Hongrie comprend encore 700.000 juifs. C’est alors qu’Adolph Eichmann rassemble deux cents de ses proches avec l’objectif de les liquider. Que faire de ces juifs ? Les envoyer à Auschwitz-Birkenau, la plus grande « machine à tuer » érigée par la main de l’homme. Ce n’est pas évident pour autant. Certes, Auschwitz est grand, mais pas encore suffisamment pour y accueillir autant de nouveaux déportés.
Ce n’est pourtant pas faute de travail : durant toute son existence, Auschwitz restera un chantier permanent : entre l’extension incessante des différents camps, la construction d’usines et les aménagements divers, on ne cesse de remuer la terre et la boue.
Birkenau était à l’origine prévu pour être un camp de prisonniers de guerre soviétiques, mais dès 1943 on le pense camp de concentration. Puisqu’il n’est pas loin de la gare, on va construire une « bahnrame » (rampe ferroviaire) pour amener les juifs au plus près des chambres à gaz. Le chantier est confié à plusieurs sociétés allemandes dont la principale est Reckmann, spécialisée dans les constructions ferroviaires, et ses employés vont superviser pendant plus d’une année le chantier au pied des chambres à gaz et des crématoires, aux première loges.
Tout se fait en même temps : les travaux, l’arrivée des trains et le meurtre dans les chambres. Plusieurs centaines de prisonniers désignés par les SS construisent les infrastructures nécessaires afin de soutenir les voies ferrées et le quai sur un sol marécageux, charrient, à dos d’hommes, les pierres pour stabiliser le terrain. Si bien que, pendant que des juifs sont assassinés, d’autres juifs travaillent sur un chantier qui permettra d’assassiner encore plus de juifs. Les travaux se dérouleront jusqu’en novembre 1944 et ne seront jamais achevés.
De ce travail mené dans des conditions d’horreur absolue, les photos de Bernard Walter et Ernst Hoffman témoignent. Entre autres.
Bernhard Walter a trente-trois ans, il est nazi depuis 1933 et SS depuis 1934. En janvier 1941, lorsqu’il est arrivé à Auschwitz, le commandant en chef Rudoph Höss l’a placé à la tête du service anthropométrique. Pourquoi ? Mystère. L’anthropométrie et la photo, il n’y connaît rien. Les nazis ne sont pas forcément aussi minutieux qu’on pouvait le penser.
Une fois en place, Walter s’adapte. Essentiellement il réalise des clichés simples, ceux, traditionnels, des autorités de surveillance : photo de face et de profil. C’est ceux que l’on trouve, par exemple, dans les dossiers de Robert Bojer (matricule 63055, déporté le 2 septembre 42) et Renée Pitiot (matricule 31629, déportée le 24 janvier 1943), mais aussi il réalise bon nombre de clichés pour les SS, surtout Höss et ses enfants. Il est l’auteur de la célèbre photographie de Rudoph Höss en famille dans son jardin, qui a servi de base historique au film La zone d’intérêt, de Jonathan Glazer en 2023.
Comme adjoint, il est assez vite affublé de Ernst Hoffmann qui lui a 43 ans et qui, tout comme Walter, est un nazi de la première heure. Dans le civil, Hoffmann était instituteur. Rien à voir avec la photo, mais il s’adapte. Les deux hommes travaillent avec zèle. C’est ce qu’on leur demande : discipline et bonne volonté.
Les caricatures du premier disent : « Chauffeur d’Etat-major de la Kommandantur, bon à tout faire, sait tout, distribue volontiers les cigares à ceux qui ne veulent pas fumer, connu comme photographe de presse lors de toutes les manifestations, importantes ou non, ne fume pas, ne boit pas, excellent compagnon et faiseur de grimaces ». Et celle du second : « Personnalité très connue dans la presse et dans le quartier, photographe, reporter, poète, dessinateur et écrivain, rapide, bonne pâte, désintéressé, toujours de bonne humeur, prêt à aider, bon camarade, élégant, toujours rasé, poudré et coiffé ». Pour un peu, on leur donnerait le bon Dieu sans confession à ces deux-là ! Peu ou prou, ils semblent correspondre à ce qu’Hannah Arendt nommait « les parfaits fonctionnaires du mal ».
Ils sont chargés de rendre compte de la vie du camp : enregistrer les détenus, photographier les travaux, rendre compte des visites officielles, prendre en photo les corps des prisonniers exécutés lors de tentatives d’évasion, réaliser des documentations diverses.
C’est ainsi que, dans : « Réimplantation des juifs de Hongrie », ils montrent l’arrivée des convois de juifs dans un centre de mise à mort, les étapes successives du processus de destruction, depuis le débarquement des trains jusqu’à la lisière des chambres à gaz. L’album, miraculeusement découvert au printemps 1945 à Dora par une déportée, Lili Jacob, elle-même juive déportée de Hongrie, constitue depuis l’une des sources visuelles majeures de l’histoire de la Shoah.
Mais pourquoi donc laisser ainsi des traces aussi tangibles de tant d’horreurs ? C’est que les nazis ont à cœur d’être précis et efficaces. On ne génocide pas au hasard et tuer n’est pas un jeu d’enfant. Donc, il faut analyser, étudier, fouiller, pour être encore plus performants la fois prochaine. Et surtout, à travers ces clichés, le parti-pris c’est de montrer la parfaite maîtrise de la situation, présenter un peuple – les juifs – totalement docile, atténuer la sévérité des faits, conserver à l’ensemble une allure de calme, un peu à l’écart de la civilisation, un endroit dans lequel l’idée même de la mort serait minimisée, adoucie, anesthésiée.
C’est d’autant plus troublant de s’apercevoir que, malgré ses efforts pour masquer la cruelle réalité, parfois la vie échappe, parfois les moutons se rebellent, parfois affleure l’idée d’un refus : sur certains clichés, les rangs de déportés ne sont pas aussi rangés que le voudraient les SS, sur un autre une femme dans la foule tire la langue au photographe, sur un autre encore un homme fait un pied de nez.
Tout un monde subsiste malgré les chambres à gaz, malgré la fumée des crématoires, malgré les privations, les coups, la mort, malgré l’horreur. Viendra le lendemain et il faut savoir conserver son optimisme.
Un extrait de presse est présenté dans la dernière partie de l’exposition : dans la section « divers » des petites annonces du Oberschlesische Zeintung à la date du 31 mai 1944, un homme signale la disparition de ses affaires dans le train reliant Mysowitz à Auschwitz. Ce même jour, selon la liste de Kassa, 12.505 juifs de Hongrie arrivaient à Birkenau. Mais qui n’a pas ses petits soucis ?
Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Auschwitz 1944, jusqu’au 23 juillet 2025 au Mémorial de la Shoah.
Incoming search terms:
- Chambre À Gaz : Juifs Les Têtes Rasés